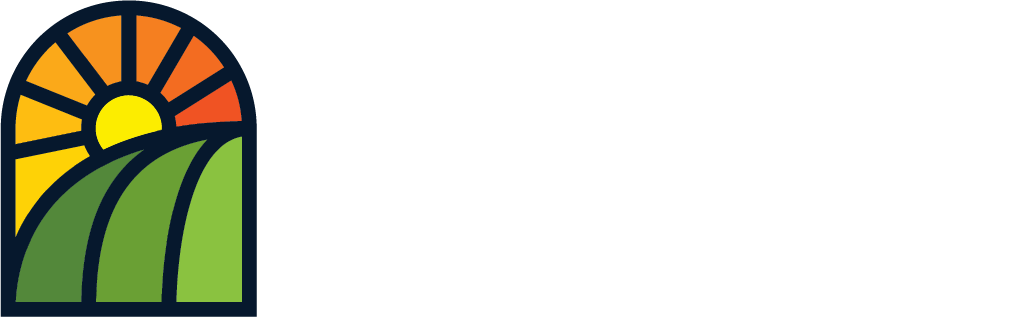Sondage national mené en 2024 auprès des agriculteur·rice·s et des éleveur·se·s
Selon le sondage, les changements climatiques, ainsi que les événements météorologiques extrêmes, représentent l’un des défis majeurs pour l’agriculture canadienne.
Malgré ces défis, les agriculteur·rice·s et les éleveur·se·s continuent d’assumer leur rôle de protecteur·rice·s de l’environnement et démontrent un fort intérêt pour l’adoption de pratiques leur permettant de renforcer leur résilience et de réduire leurs émissions de GES, telles que la gestion améliorée des fertilisants azotés, les cultures de couverture et le pâturage en rotation.
Pendant la saison agricole 2024, Fermiers pour la transition climatique (FTC) a fait appel à la firme de recherche marketing Léger afin de mener un sondage national auprès des producteur·rice·s canadiens permettant de :
Sonder la manière dont les changements climatiques sont perçus. Connaître les préoccupations et les attentes des agriculteur·rice·s et des éleveur·se·s face aux changements climatiques.
Établir les priorités environnementales. Déterminer les aspects environnementaux qui comptent le plus pour les producteur·rice·s.
Comprendre les besoins en matière de soutien. Déterminer quelles mesures de soutien sont nécessaires pour que les producteur·rice·s puissent déployer à plus vaste échelle des pratiques promouvant la durabilité, renforçant la résilience et réduisant les émissions de GES.
Guider l’élaboration de politiques et de programmes. Fournir de l’information permettant d’élaborer des politiques et des programmes efficaces destinés aux agriculteur·rice·s et aux éleveur·se·s.
Le sondage, qui a été rempli par 858 agriculteur·rice·s et éleveur·se·s, fournit de précieuses informations sur leurs préoccupations, leurs priorités environnementales et les mesures de soutien dont ils ont besoin pour rendre leurs exploitations agricoles plus résilientes.
Ce rapport présente les principaux constats du sondage de 2024. Ceux-ci fournissent des informations utiles pour guider l’élaboration de politiques et de programmes climatiques qui aideront les agriculteur·rice·s et les éleveur·se·s à renforcer leur résilience tout en maintenant leur productivité.
Principaux constats
Les changements climatiques constituent un défi majeur pour la prochaine décennie
Tout au début du sondage, les agriculteur·rice·s et les éleveur·se·s devaient répondre à une question ouverte leur demandant quel était le principal défi que devra relever le secteur agricole au cours de la prochaine décennie. La réponse la plus fréquente qu’ils ont donnée était les changements climatiques.
Les agriculteur·rice·s et les éleveur·se·s subissent déjà les conséquences des événements météorologiques extrêmes
76 % des agriculteur·rice·s et des éleveur·se·s déclarent avoir été affectés par des événements météorologiques extrêmes au cours des cinq dernières années.
Les agriculteur·rice·s et les éleveur·se·s redoutent les conséquences futures des changements climatiques
Les producteur·rice·s craignent que les changements climatiques mènent à la mise en place de politiques et de réglementations plus restrictives, réduisent leurs revenus et leurs rendements, et mettent à mal leur santé mentale.
Les agriculteur·rice·s et les éleveur·se·s se considèrent comme de bons protecteur·trice·s de l’environnement
87 % des agriculteur·rice·s et des éleveur·se·s estiment être de bons protecteur·rice·s des terres, et 47 % d’entre eux considèrent pouvoir en faire davantage pour améliorer les résultats environnementaux de leurs exploitations.
La santé des sols et la résilience à la ferme sont les principales priorités environnementales
Près de 94 % des agriculteur·rice·s et des éleveur·se·s considèrent que l’amélioration de la santé des sols constitue une priorité essentielle, et 87 % d’entre eux accordent la priorité à l’amélioration de la résilience des fermes.
Il existe un fort intérêt pour les pratiques permettant d’accroître la résilience et de réduire les émissions de GES
Les pratiques telles que la gestion améliorée des fertilisants azotés, le semis direct ou le travail réduit des sols, les cultures de couverture, la conservation des habitats propices à la faune sauvage et le pâturage en rotation suscitent un fort intérêt.
La rentabilité favorise l’adoption de nouvelles pratiques
Les agriculteur·rice·s et les éleveur·se·s ont indiqué que les facteurs d’ordre financiers, tels que l’augmentation de la rentabilité et l’amélioration de la productivité, constituent les principales motivations favorisant l’adoption de nouvelles pratiques.
Une gamme de mesures de soutien est nécessaire
Les producteur·rice·s veulent avoir accès à diverses mesures de soutien (ex. : soutien technique et formation, incitatifs financiers, outils de gestion des risques, primes pour les produits durables) pour adopter des pratiques leur permettant d’accroître leur résilience et de réduire leurs émissions de GES.
Le soutien technique et la formation sont essentiels
Les agriculteur·rice·s et les éleveur·se·s indiquent que c’est auprès d’autres producteur·rice·s qu’ils apprennent le mieux alors que plus de 86 % d’entre eux ont rapporté se tourner vers leurs pairs pour obtenir du soutien technique.
Implications politiques
Investir dans la santé des sols et la résilience à la ferme
Puisque les agriculteur·rice·s considèrent la santé des sols et la résilience comme prioritaires, les politiques devraient prévoir du financement et des programmes ciblés pour renforcer ces aspects afin de soutenir la viabilité à long terme des exploitations et la durabilité environnementale.
Mettre l’accent sur les solutions élaborées par les agriculteur·rice·s et les éleveur·se·s
Les agriculteur·rice·s et les éleveur·se·s craignent que les changements climatiques mènent à la mise en place de politiques gouvernementales restrictives qui menaceront leur gagne-pain. Afin de favoriser l’adhésion aux solutions climatiques et de promouvoir leur adoption, les politiques devraient privilégier les solutions élaborées par les agriculteur·rice·s et les éleveur·se·s, les pratiques éprouvées, de même que les réseaux de pairs.
Élaborer des politiques favorables aux producteur·rice·s
Si les politiques sont flexibles, axées sur les incitatifs et permettent d’outiller les agriculteur·rice·s et les éleveur·se·s, elles seront mieux accueillies et promouvront plus efficacement la durabilité, tout en répondant aux besoins financiers des producteur·rice·s.
Les avantages économiques doivent être soulignés
Les politiques devraient bien faire ressortir les avantages financiers associés aux pratiques, tels que l’accroissement de la productivité et de la rentabilité.
Offrir de multiples formes de soutien
Les producteur·rice·s ont besoin de diverses mesures de soutien pour adopter de nouvelles pratiques. Les cadres politiques devraient offrir une gamme de mesures de soutien composé de soutien technique et de formation, d’incitatifs financiers, d’outils de gestion des risques, et des solutions fondées sur les marchés telles que des primes pour les produits durables.
Tenir compte des différences régionales
Bien que le sondage ait révélé que les changements climatiques sont une importante source de préoccupation parmi les producteur·rice·s, une analyse des réponses obtenues sous un angle régional souligne la nécessité d’adopter des politiques qui tiennent compte de différents points de vue. Des mesures de soutien adaptées à ces différences garantiront l’efficacité et la pertinence des politiques.
Méthodologie
Le sondage téléphonique a été commandé par FTC et réalisé par Léger entre le 8 août et le 4 septembre 2024. Au total, 898 agriculteur·rice·s et éleveur·se·s répartis à travers le Canada ont répondu au sondage, et 858 d’entre eux l’ont rempli en entier. Les répondant·e·s représentaient divers types de production, tailles d’exploitation et régions du Canada, ce qui a permis de sonder une vaste gamme de points de vue parmi les agriculteur·rice·s et des éleveur·se·s de l’ensemble du pays. Les résultats du sondage n’ont pas été pondérés selon les données de Statistique Canada. Pour prendre connaissance des caractéristiques sociodémographiques des répondant·e·s, consultez l’annexe 1.
Marge d’erreur : Aux fins de comparaison, la marge d’erreur pour un échantillon probabiliste de cette taille n’excède pas ±3,3 %, avec un niveau de confiance de 95 % (19 fois sur 20). Consultez l’annexe 3 pour plus de détails sur l’élaboration du sondage.